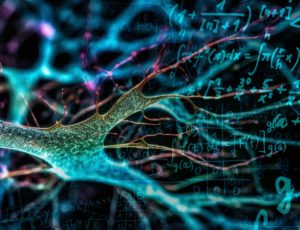Chloé-Agathe Azencott : « Je ne rêvais pas de faire de l’intelligence artificielle ! »
⏱ 4 minC’est avant tout son intérêt pour l’informatique appliquée à la santé qui a mené Chloé-Agathe Azencott à devenir data scientist. D’une épreuve de concours à un stage en bio-informatique, d’une thèse à un postdoc, entre la France, les États-Unis et l’Allemagne, elle nous raconte son parcours sans lien avec son oncle, Robert Azencott, un des pionniers français de l’intelligence artificielle.
« J’ai compris qu’il y avait un rapport entre mon sujet de stage et les travaux de mon oncle lorsqu’on a commencé à me poser des questions sur mon patronyme… Mais je n’avais jamais discuté de ces sujets avec lui auparavant. Je savais seulement qu’il avait travaillé sur la vision artificielle. Cela n’a absolument pas influencé mon parcours. D’ailleurs, ce n’est qu’en 2005 que j’ai découvert ce qu’était le machine learning, lors de mon stage de master au centre de bio-informatique de Mines ParisTech (CBio), créé quelques années plus tôt par Jean-Philippe Vert.
Pour ma part, j’étais passionnée par les maths et l’informatique. Et, depuis le lycée, j’avais vaguement l’idée de m’orienter vers la recherche, sans trop savoir en quoi cela consistait. Pendant ma prépa, j’ai découvert la bio-informatique lors de mon TIPELe Travail d’initiative personnelle encadré (TIPE) est une épreuve commune à la plupart des concours d’entrée aux grandes écoles scientifiques.. J’ai choisi de travailler sur l’alignement de séquences dans le but de comparer des génomes. Et à IMT Atlantique (ex Télécom Bretagne) à Brest, que j’ai intégrée en 2002, j’ai choisi de faire un master recherche en parallèle de ma 3eannée d’école d’ingénieur. Cela me permettait de remplacer le stage d’ingénieur de 3eannée par un stage de sixmois dans un laboratoire de recherche.
Hasard et nécessité des conférences…
Et c’est, immergée depuis un certain temps dans l’équipe dans laquelle je faisais ce stage de master, que j’ai compris que les méthodes à noyaux sur lesquelles on travaillait, très à la mode à ce moment-là, appartenaient à un domaine beaucoup plus large appelé le machine learning. J’ignorais tout de ces méthodes d’apprentissage, encore peu connues. Une chose est sûre : ça m’a beaucoup plu, et convaincu de faire de la recherche. Mais quand j’ai décidé de faire une thèse, on était en juin, il était trop tard… C’est Jean-Philippe Vert, mon directeur de stage, qui m’a sauvé la mise : lors d’une conférence, il a croisé Pierre Baldi, professeur d’informatique à l’université d’Irvine, en Californie, qui cherchait un doctorant avec mon profil.
J’ai ainsi appliqué le machine learning aux données issues de molécules organiques avec une visée pharmaceutique et thérapeutique. Après avoir soutenu ma thèse en 2010, j’ai voulu rentrer en Europe. J’ai rejoint le laboratoire de Karsten Borgwardt (croisé lors d’une conférence…), alors au Max Planck Institute de Tübingen, en Allemagne, pour faire un postdoc pendant trois ans. Cela a été l’occasion, avec d’autres chercheurs et chercheuses, de défricher un nouveau champ de recherches autour de cibles thérapeutiques identifiées à partir de données génomiques : le GWAS (Genome Wide Association Study) qui consiste à mesurer, sur des échantillons de génome, la présence ou l’absence de mutations pour en déduire des facteurs de risques (par exemple de développer un cancer). La complexité de ce problème statistique vient du fait qu’il y a beaucoup plus de variables (des centaines de milliers) que d’échantillons, ce qui pose en plus des problèmes algorithmiques spécifiques en raison des besoins considérables en temps de calcul et en capacité de mémoire.
Hasard, chance, coïncidence… J’ai alors croisé Jean-Philippe Vert dans une conférence : je cherchais une nouvelle affectation en France, il créait un poste de chargé de recherche au CBio ! Un poste qui me correspondait tout à fait. Retour aux sources donc, en 2013, huit ans après mon stage de master. Depuis 2018, je suis maître de conférences: j’enseigne le machine learning et la bio-informatique à Mines ParisTech, Centrale Supelec et dans le cadre d’un Mooc. Sans surprise, je conseille aux étudiants, doctorants, chercheurs d’aller autant que possible à des conférences pour rencontrer leurs pairs. En leur souhaitant d’avoir autant de chance que moi !
Data scientist au féminin
Deux aspects me paraissent importants à évoquer. D’une part, je voudrais souligner que le fait d’être une femme ne facilite pas la tâche. Dès ma thèse, j’ai été confrontée à des remarques dégradantes quant aux moindres capacités en maths des femmes… de la part d’autres étudiants, et à cette impression désagréable de ne pas être tout à fait à ma place dans les conférences de machine learning, au milieu de ces boys clubs. C’est en train de changer, et je suis heureuse d’y contribuer, par exemple via les meet up du WiMLDS (Women in Machine Learning and Data Science) que nous organisons à Paris avec Caroline Chavier depuis 2017 pour donner la parole à des femmes data scientists [voir l’article dédié au WiMLDS dans DAP, NDLR]. Inversement, des chercheuses refusent parfois de participer à des événements auxquels elles sont invitées parce qu’elles sentent (à tort ou à raison) qu’on fait appel à elles d’abord en tant que femmes et non pour leurs recherches, pour créer une pseudo-équité. Cela m’arrive encore aujourd’hui. À mon sens, il faut profiter de ces invitations pour montrer qu’on a des choses intéressantes à dire !
D’autre part, je voudrais évoquer le « syndrome de l’imposteur », très fréquent dans le milieu de la recherche, notamment chez les doctorants : c’est une forme de doute sur nos qualifications qui nous amène à penser que notre réussite est due au hasard. Cette propension à se remettre sans cesse en question est notamment liée à la nature même de l’activité de chercheur, seul face à l’inconnu. Il faut oser parler de ce mal-être avec ses pairs, en discuter, se renseigner, il y a de plus en plus de ressources sur le sujet [par exemple, cette BD, NDLR]. Il ne faut surtout pas se laisser abattre ! »
Propos recueillis par Isabelle Bellin
Illustration à la une, Chloé-Agathe Azencott © Nicolas Ravelli – DotAI 2018.