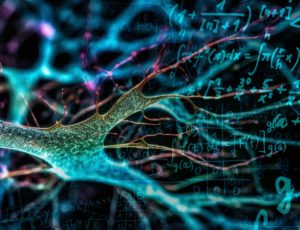L’art numérique fait son entrée au musée
⏱ 6 minEntretien avec Laurence Bertrand Dorléac, professeur d’histoire de l’art à Sciences Po, commissaire de l’exposition Artistes et robots au Grand Palais (5 avril au 9 juillet 2018, Paris). Une exposition qui donne à voir et à réfléchir sur une trentaine d’œuvres créées à l’aide de robots ou d’intelligences artificielles.
Vous avez choisi les œuvres exposées en raison de leur intérêt artistique. Selon quels critères ?
Laurence Bertrand Dorléac : Décider ce qui mérite ou non le qualificatif d’œuvre d’art résulte de critères en partie subjectifs mais aussi objectifs. Les œuvres choisies sont à replacer dans une histoire de l’art sur la longue durée. Avec cette exposition qui pose le problème de « l’imagination artificielle », à la croisée de la robotique et de l’algorithmique, nous voudrions amener le public à réfléchir à ce qui fait qu’une œuvre est une œuvre et qu’un artiste est un artiste, mais aussi au statut de la technique dans le processus artistique. Jusque-là, ce type d’œuvres restait cantonné à des musées scientifiques, où il était considéré sous l’angle technique et non artistique. Or, nous avons installé ces puissantes créations au Grand Palais comme des œuvres d’art à part entière. Depuis la Préhistoire et les peintures rupestres, les artistes ont détourné les nouvelles techniques pour les soumettre à leurs interrogations et à leur poésie. Les outils numériques offrent l’opportunité de reposer ces questions ancestrales avec des moyens renouvelés.
Ces nouvelles machines à créer seraient-elles donc au service de la même quête ancestrale ?
L B.-D. : En art comme en littérature, on a toujours rêvé de créatures artificielles, autonomes, capables de remplacer, voire de dépasser les humains. Depuis l’Antiquité, cette idée est liée à la fiction. On la trouve dès les Psaumes (460 avant J.-C.) quand David loue Dieu de l’avoir si bien « tissé ». Dans cette lignée, les exemples historiques de créatures artificielles qui échappent à leur créateur sont légion, comme le Golem, au XVIe siècle ou, bien plus tard, au XIXe, la créature de Frankenstein, imaginée par Mary Shelley, qui menace de détruire l’humanité. Toute la science-fiction avec son lot de créatures, bonnes ou mauvaises, repose sur cette très vieille histoire.
Avec ces nouvelles technologies, qu’est-ce que les artistes peuvent créer qu’ils ne pouvaient pas faire avec les média traditionnels ?
L B.-D. : Prenons l’exemple de l’œuvre d’Oscar Sharp, Sunspring, créée en 2016 : c’est une série créée par une intelligence artificielle en apprentissage automatique à partir d’un corpus de plusieurs dizaines de scénarios de science-fiction. Cette intelligence artificielle, baptisée Benjamin, a produit un scénario à partir d’une « dissection » à la lettre. Le résultat est très drôle et l’on sent quelque chose de bizarre. Mais là encore, on peut rattacher cette œuvre à l’histoire, en l’occurrence au dadaïsme : ce scénario tient de la « bêtise artificielle », au sens de Dada qui voulait bouleverser le langage, bafouiller à nouveau au moment de la Première guerre mondiale, en réaction à la Propagande qui « usait » affreusement la langue. Ce qui est intéressant avec cette œuvre de Sharp comme avec d’autres que nous présentons, c’est qu’on ne sait pas, en la regardant, comment elle est produite. La technique n’est pas du tout visible, on l’oublie et c’est tant mieux. Le cartel est là pour donner des informations si l’on veut en savoir plus.
OSCAR SHARP
Sunspring, 2016 Court métrage, 9 mn
Scénario : « Benjamin », logiciel d’intelligence artificielle
Production : End Cue
© Sunspring Film LLC
A quel point ces nouvelles technologies renforcent-elles l’autonomie de l’œuvre par rapport à son auteur ?
L B.-D. : À la manière d’un chercheur, tout artiste travaille plus ou moins de façon empirique, en cherchant à produire un résultat qui, finalement, lui échappe et dont souvent il a perdu le cheminement. L’art numérique n’invente rien de ce point de vue-là : les artistes imaginent, expérimentent un nouveau type d’œuvres. La principale différence est que l’artiste délègue une partie de ses pouvoirs à des machines, ordinateurs ou robots, à partir de calculs, d’algorithmes. Après tout, au XVIIIe siècle, Jacques-Louis David déléguait aussi une partie de son travail à ses nombreux élèves dans son atelier. Mais David savait exactement ce qu’il voulait. Désormais, potentiellement, on sait comment l’œuvre commence mais pas quand ni comment elle finira. Pourtant, c’est, bel et bien toujours l’artiste qui pilote et impose son « style », la machine ne fait que prolonger, étendre, multiplier son modèle d’origine.
Les œuvres exposées sont immersives, génératives, interactives. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
L B.-D. : Les œuvres immersives sont un vieux rêve bien incarné dans le bassin aux Nymphéas installé par Monet très bas dans les salles ovales du musée de l’Orangerie (Paris) pour nous immerger dans le paysage. L’œuvre de Raquel Kogan (Reflexao 2) est de cet ordre-là. Le visiteur baigne littéralement dans les chiffres, symboles de l’algorithmique. Ces chiffres lui collent à la peau comme le numérique nous envahit.

RAQUEL KOGAN
Reflexão #2, 2005
Installation interactive, logiciels customisés, miroirs et projection
Dimensions variables
© Photo Aldo Paredes pour la Rmn-Grand Palais, 2018
Les œuvres génératives, quant à elles, mettent en exergue la combinatoire, la possibilité de reproduire à l’infini, l’impossibilité de « faire le tour », d’explorer une œuvre sous toutes ses facettes à l’image de ce qu’avait proposé Raymond Queneau en 1961 en poésie combinatoire dans ses Cent mille milliards de poèmesCe livre est composé de dix feuilles, séparées en quatorze bandes horizontales portant chacune un vers. Le lecteur peut choisir, en tournant les bandes, sa version des 107 poèmes possibles. L’art digital excelle dans ce domaine : l’artiste peut générer des milliards d’images selon des combinaisons de couleur et de forme différentes. De quoi exciter sans fin notre désir d’images, notre pulsion scopique.
Quant à l’interactivité, c’est la capacité de l’œuvre à changer avec le public, via le corps, le mouvement, la voix ou le souffle. Un bel exemple d’œuvre immersive, générative et interactive est donné par Miguel Chevalier, un véritable descendant de Monet : avec Extra-Natural, il crée un jardin imaginaire, une « nature artificielle » dans laquelle il sème des graines informatiques, autant de fleurs nouvelles qui poussent de façon aléatoire et exponentielle. Elles croissent et disparaissent. Elles se courbent différemment lorsque passent les visiteurs. Le spectacle est hypnotique !
Extra-Natural 2018 – Miguel Chevalier from Miguel Chevalier on Vimeo.
MIGUEL CHEVALIER
Extra-Natural, 2018
Exposition Artistes & Robots, Grand Palais, Paris
Œuvre de réalité virtuelle générative et interactive
Logiciels : Cyrille Henry & Antoine Villeret
Production technique : Voxels Productions
Courtesy Galerie Lélia Mordoch, Paris/Miami
Cette interaction avec le public est-elle une des spécificités de l’art numérique ?
L B.-D. : Toute œuvre moderne suppose à des degrés divers cette interactivité avec celle ou celui qui la regarde. Marcel Duchamp disait que : « Ce sont les regardeurs qui font le tableau », façon de dire que nous finissons l’œuvre en l’interprétant chacun à notre façon selon notre culture et selon notre inconscient, d’autant plus si l’œuvre est ouverte et potentielle. Dans l’art numérique, nous agissons désormais sur l’œuvre. Finalement, celle-ci peut être créée à trois ou à quatre : l’artiste, l’ingénieur, le robot et le public, certains artistes étant aussi ingénieurs, comme Patrick Tresset avec ses bras robotiques qui dessinent des natures mortes, jamais les mêmes.

PATRICK TRESSET
Human Study #2.d La Grande Vanité au corbeau et au renard, 2004-2017
Trois robots, un renard et un corbeau empaillés, dessins sur papier
© Photo Aldo Paredes pour la Rmn-Grand Palais, 2018
Que répondez-vous à ceux qui brandissent un risque d’hégémonie de cette nouvelle forme d’art ?
L B.-D. : Qu’il n’y a aucune volonté d’hégémonie chez ces artistes qui utilisent comme des outils de leur temps les nouvelles technologies. Pas plus qu’il n’y en a eu avec l’avènement de la photographie, cet art qui a eu bien du mal à se faire reconnaitre à ses débuts et contre lequel toute l’Académie des Beaux-Arts, Ingres en tête, a signé des pétitions. La photographie, à son époque, comme l’art numérique aujourd’hui, a bouleversé le pré carré artistique. Certains ont aujourd’hui peur que la peinture ne disparaisse, de la même façon que Picasso le craignait dans les années 1900 avec l’avènement de la photographie avant de peindre les chefs d’œuvre que l’on connait… Tous ces média artistiques sont en concurrence mais cette concurrence est loyale et ces média ne s’éliminent pas les uns et les autres. Ils s’observent et s’enrichissent mutuellement. Ce qui fait qu’une œuvre est une œuvre ne dépend pas avant tout de sa technique mais de sa puissance et de son pouvoir de provoquer en nous de la réflexion et des affects. Comme depuis la nuit des temps.
Propos recueillis par Isabelle Bellin