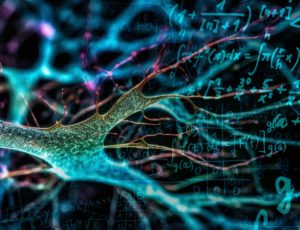« Plus qu’avec le privé, notre recherche en intelligence artificielle est en concurrence avec les acteurs publics mondiaux »
⏱ 5 minEntretien avec Antoine Petit, président-directeur général du CNRS. (Photo ©CNRS)
Depuis quelques années, les chercheurs en intelligence artificielle (IA) ont beaucoup d’opportunités de recrutement dans l’industrie, dans les GAFA et autres NATU (Netflix, AirBnb, Tesla, Uber). Comment considérez-vous cette situation ?
Antoine Petit : De fait, les industriels ont les moyens d’embaucher beaucoup des chercheurs académiques en leur faisant des ponts d’or. Mais ce n’est pas dans leur intérêt. Et ils le savent. Car, à long terme, cela tarirait leur propre vivier de recrutement : sans bons professeurs, il y aura moins de bons étudiants et donc moins de talents formés, que ce soit des doctorants, des diplômés de master ou de licence. Quelques chercheurs académiques sont effectivement partis dans le privé, mais pour l’instant c’est un tout petit nombre. Pour que cette nouvelle tendance soit bénéfique pour tous, il faut surtout qu’on parvienne à développer un système de « double position » comme cela se fait beaucoup aux États-Unis ou au Canada. Le principe est que le chercheur travaille quelques jours par semaine au CNRS ou à l’université, et quelques jours chez l’industriel. Cela lui permet de poursuivre son enseignement, de garder ses étudiants tout en ayant un pied dans le privé. L’exemple emblématique en la matière est celui de Yann Le Cun, directeur scientifique de la recherche en IA de Facebook, tout en restant professeur à l’université de New York, même s’il ne doit plus beaucoup y enseigner. De tels montages, originaux, posent également des questions inédites en termes de propriété intellectuelle ; les américains ou les canadiens gèrent cela très bien, on devrait être capables de faire de même !
Ces recrutements dans le privé ne risquent-ils pas, par ailleurs, de « geler » des postes dans le public ?
A.P. : Formellement, oui, dans le cas de ce qu’on appelle des détachements. Je suis moi-même dans cette situation : je suis professeur des universités à l’ENS-Paris-Saclay, détaché au CNRS. Mon poste d’enseignant est effectivement « gelé » mais dans la réalité, pour de gros établissements de recherche, ce n’est pas un problème, car ces postes se gèrent à une échelle globale et non individuelle. L’autre cas de figure dans la fonction publique est la « mise à disposition à temps partiel », statut qui permet ces doubles positions et ne pose donc pas de problème à ce niveau-là.
Cette concurrence entre recherche privée et publique vous inquiète-telle ?
A.P. : Pour l’instant, non, cela ne m’inquiète pas. Sous réserve qu’il n’y ait pas d’hémorragie. N’oublions pas que la mobilité est un phénomène à encourager, on ne peut pas s’en plaindre alors qu’on l’appelle de nos vœux. Il faut juste qu’elle profite à l’ensemble du système. Ces doubles positions, que certains chercheurs ont réussi à avoir en France, comme Cordelia Schmid, qui partage son temps entre INRIA et Google, permettent par ailleurs de développer des relations entre recherche publique et privée. Cela dit, même si les chercheurs bénéficient d’une grande liberté chez certains industriels, elle n’est pas du même ordre que dans la recherche académique. Les chercheurs en sont bien conscients, et beaucoup restent trop attachés à cette liberté pour quitter définitivement la recherche publique. Mais ils ont le choix en matière de recherche publique…
Vous voulez dire que la concurrence, dans la recherche en IA, serait davantage avec les acteurs publics à l’échelle mondiale qu’entre public et privé ?
A.P. : Effectivement. Nous devons être très vigilants en matière de concurrence avec les autres acteurs académiques mondiaux. Même si nous n’en sommes qu’à des signaux faibles. Pour l’instant, nos concours de recrutement sont toujours au meilleur niveau mondial et nous avons des laboratoires de qualité et des chercheurs renommés. L’écosystème de recherche français continue à attirer : nous recrutons au CNRS plus de 30 % de chercheurs permanents étrangers, de tous les pays. Mais il faut se préoccuper de cette concurrence qui concerne particulièrement l’IA actuellement, comme elle a touché en d’autres temps l’économie, et a abouti à la création de fondations [1] à Paris et à Toulouse. Car un jeune chercheur brillant en IA a aujourd’hui l’embarras du choix en matière de recherche académique. En général, il prend en compte trois éléments : l’environnement scientifique global – on l’a dit, celui de la France est de qualité, c’est aussi une des raisons pour lesquelles Google ou Facebook ont ouvert leurs laboratoires IA en France –, son environnement de recherche individuel, autrement dit les possibilités qu’on lui offre pour recruter doctorants, post-doctorants et ingénieurs, enfin sa rémunération personnelle. Ce sont sur ces deux derniers points que nous avons le plus de progrès à faire en France. Au CNRS, et plus généralement en France, nous devons mettre en place des « packages » pour offrir des environnements scientifiques individuels attractifs. Nous devons aussi collectivement réfléchir aux rémunérations, sans dogme ni idéologie. Aujourd’hui, au CNRS, quel que soit le niveau d’un chercheur, lui octroyer une prime individuelle est impossible, ou presque, et nécessite l’accord du conseil d’administration. Il nous faut assouplir cette procédure. C’est simple à comprendre ! Faisons une analogie sportive : on ne peut pas prétendre gagner en ligue des champions sans attirer les meilleurs joueurs, et sans leur offrir un environnement du meilleur niveau dans tous les domaines, il faut donc en payer le prix.
Comment envisagez-vous de garder ou de faire venir des chercheurs en France ?
A.P. : Heureusement, il n’y a pas que l’argent dans la vie… La première motivation d’un chercheur est la science et la reconnaissance par ses pairs. Il ne demande pas à gagner des millions. Mais il est vrai que, quand, après avoir soutenu sa thèse et enchaîné un voire deux post-doc – soit Bac+10 à +12 –, un jeune chercheur se voit offrir moins de 3 000 euros brut en entrant au CNRS, et doit demander une caution à ses parents pour louer un appartement… on comprend légitimement qu’il hésite avec un poste payé le triple à Lausanne ou Zurich. Pour autant, il ne s’agit pas d’aligner nos salaires avec ces pays. La qualité de la vie en France compense en partie ce manque à gagner, avec une scolarité gratuite, une couverture maladie peu onéreuse et de qualité, etc. Il ne faut pas l’oublier non plus, ça compte. Mais il faut trouver le bon équilibre. Je le répète : la clé est, à minima, de fournir aux chercheurs que l’on veut attirer en France la capacité financière de recruter de très bons doctorants ou post-doctorants.
Pour cela, vous préconisez de s’inspirer du modèle canadien, qui offre des chaires à des chercheurs de renom. Comment procèdent-ils ?
A.P. : Je fais partie d’un comité international qui valide les propositions de chaires faites par les trois centres d’IA labellisés par le Canada. Concrètement, ces chaires sont attribuées à des chercheurs qui ont un poste à l’université, certains ayant en plus un pied dans le monde industriel. J’avoue que je suis impressionné par les CV que je vois passer, d’une très grande qualité. Il faut reconnaître que les moyens octroyés par le gouvernement canadien sont importants. Leur système comporte un bonus financier personnel pour le chercheur (comme on l’a vu, difficile à envisager en France pour l’instant) et une somme conséquente pour le recrutement de son équipe, comme on vient de l’évoquer. C’est avec ce genre de chaires, où les chercheurs bénéficient d’une grande liberté de recherche, que nous sommes et serons de plus en plus en concurrence. Il nous faut veiller à ces aspects dans les 190 chaires qui seront bientôt créées en France dans le cadre de la stratégie nationale AI for Humanity annoncée en novembre dernier [lire l’article sur la stratégie nationale en IA, à venir dans ce dossier, NDLR]. Cette notion de chaire y est centrale, mais ces chaires doivent être attractives et simples en pratique ; selon la formule consacrée : attention aux diables (administratifs) qui se cachent souvent dans les détails.
[1] L’École d’économie de Paris (EEP) et Toulouse School of Economics (TSE) ont été créées respectivement en 2006 et 2007.
Propos recueillis par Isabelle Bellin